Navigation des services
Recherche
Durant les derniers jours de l’année 1999, les inquiétudes et les préparatifs étaient focalisés sur le redouté changement de millénaire. Pendant des mois, on avait évoqué des scénarios catastrophes liés à ce changement de date historique, le fameux « bug de l’an 2000 ». Une catastrophe naturelle nous a donc plutôt surpris.
Après une année 1999 marquée par un hiver à avalanches et par des inondations, la tempête Lothar a dépassé en termes de force toutes les attentes et expériences en matière de phénomènes naturels. Jamais un événement naturel n'avait causé en Suisse des dégâts d'un montant aussi élevé, près de 1,8 milliard de francs. La forêt et le bâti ont été les plus touchés. La tempête a fait 14 victimes humaines directes ; au moins quinze autres ont péri lors des travaux de déblaiement qui ont suivi.
À l'occasion du 25e anniversaire de Lothar, revenons dans un premier temps sur la chronologie de cet événement météorologique mémorable.
L'évolution synoptique de la tempête Lothar
Pour comprendre le développement d'une tempête aussi violente que Lothar, il faut considérer la situation météorologique générale et les antécédents sur l'Atlantique Nord et l'Europe. À partir du 20 décembre 1999, le courant d’altitude a été déterminé par une vaste zone de basse pression dont le centre se trouvait près de l'Islande. Les jours suivants, cette dépression a été alimentée de manière continue par de l'air froid polaire en provenance de l'Arctique et par de l'air chaud en provenance de l'Atlantique subtropical.
Le 24 décembre 1999, la crête de haute pression qui s’étendait jusqu'alors sur l'Europe centrale et orientale s’est complètement retirée. Le courant d'altitude zonal a ainsi pu s'étendre de l'Atlantique Nord jusqu'à l'Europe centrale. Une dépression secondaire insérée dans ce courant s'est déplacée de l'Irlande vers la mer du Nord en se creusant fortement et s'est finalement dirigée vers les îles Féroé, où elle s’est positionnée, prenant la fonction de dépression principale. Cette zone de basse pression a ensuite été baptisée « Kurt ». Le front froid de « Kurt » a traversé la Suisse le 25 décembre 1999, accompagné de vents violents.
Dans la limite de masse d’air de « Kurt », qui s’étirait alors jusqu’à l’autre extrémité de l’Atlantique, une ondulation frontale s'est développée le 24 décembre 1999 au sud de Terre-Neuve dans la basse troposphère, avec une pression atmosphérique initiale de 1005 hPa. Se renforçant constamment, l'ondulation s'est déplacée vers l'est dans un environnement optimal avec un apport continu d'air polaire et d'air subtropical chaud et humide. Le 25 décembre 1999, elle s'était déjà développée en dépression secondaire, avec une pression de 995 hPa en son centre. Jusque-là, rien ne laissait présager une évolution aussi extrême que celle qui s'est produite le lendemain.

Le 26 décembre 1999 à 00 UTC, la dépression secondaire qui a donné naissance plus tard à la tempête Lothar se trouvait à environ 300 km au sud de l'Irlande et présentait une pression centrale de 985 hPa. Au cours des six heures qui ont suivi, une évolution a eu lieu, qui n'avait encore jamais été observée en Europe au cours des 30 dernières années au moins. La pression atmosphérique au centre de la dépression secondaire, qui se trouvait au-dessus de Rouen au nord de Paris, a chuté de 25 hPa pour atteindre 960 hPa. À Rouen même, une chute de pression de 26 hPa a été mesurée en trois heures ! La vitesse des vents a rapidement augmenté avec ce creusement extrême, atteignant déjà la force d'un ouragan sur la France. Cette évolution exceptionnelle a été rendue possible par :
- une zone frontale très développée, orientée de manière zonale, avec de forts contrastes de température, ce qui a entraîné un très fort courant d'altitude (courant-jet ou jet stream en anglais) ;
- la disposition verticale optimale et donc l'interaction entre le courant-jet et la dépression au sol ;
- l'apport continu d'air subtropical, riche en vapeur d'eau, qui a largement contribué au creusement de la dépression par la chaleur latente libérée.
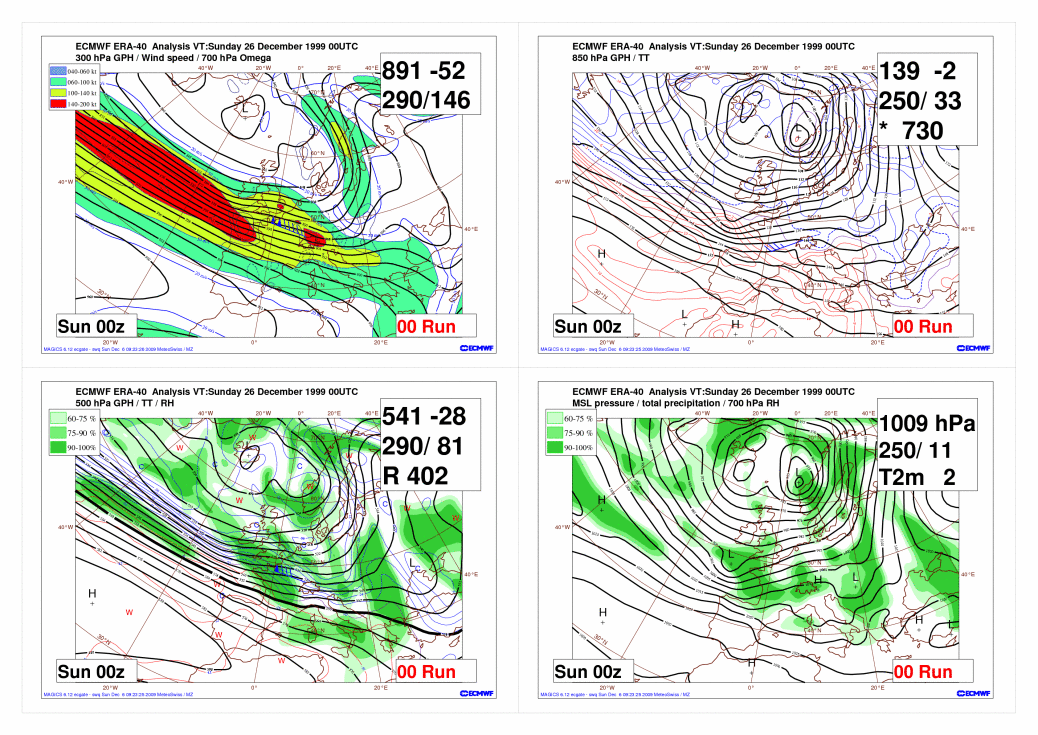
Après 06 UTC, le 26 décembre 1999, la tempête Lothar s'est rapidement déplacée vers l'est sur l'Europe centrale. Les vents les plus forts et les plus dévastateurs se sont alors produits dans le secteur au sud de la dépression. Des vents déchaînés au passage du front froid atteignirent la Suisse en fin de matinée et touchèrent tout le nord des Alpes peu après midi. À ce moment-là, Lothar commençait déjà à se combler progressivement, avec une pression en son centre de 975 hPa au-dessus de l'Allemagne centrale (image 3). De l'Allemagne, Lothar s'est déplacé vers la Pologne, où il a continué à se combler. La vitesse des vents et leur puissance de destruction ont alors nettement diminué. Le très fort courant d'ouest en altitude a cependant persisté, de sorte qu'une autre dépression secondaire a pu se transformer en tempête. Celle-ci, nommée Martin, se déplaça vers l'est du 27 au 28 décembre 1999 sur une trajectoire légèrement plus au sud et provoqua d'importants dégâts principalement dans le sud-ouest de la France, la Suisse romande étant à nouveau touchée, mais de manière marginale.
Animation de l'image satellite de l'ouragan Lothar (26.12.1999 au 27.12.1999 00UTC).
- Atlantique Est : L'animation commence à 00 UTC avec la formation de Lothar sur l'Atlantique Est. La dépression tempétueuse se développe très rapidement à partir d'une ondulation du front polaire.
- Avancée rapide : Lothar se déplace ensuite rapidement vers le continent européen en continuant de se creuser.
- Passage sur l'Europe : la dépression atteint le continent européen et se dirige vers la République tchèque et la Pologne en passant par la France et le centre de l'Allemagne. Les bandes nuageuses en forme de spirale, typiques des tempêtes, sont bien visibles.
Passage de Lothar sur la Suisse
Le front froid a touché la Suisse vers 09.00 UTC dans la région du Jura neuchâtelois. Il a traversé les hauteurs du Jura dans la demi-heure qui a suivi, avec une forme d’arc inhabituelle (image 7). À La Brévine, une rafale a atteint 157 km/h, et même 170 km/h à Delémont. Sur le Chasseral, à 1600 m d'altitude, les rafales étaient à peine plus élevées (177 km/h).
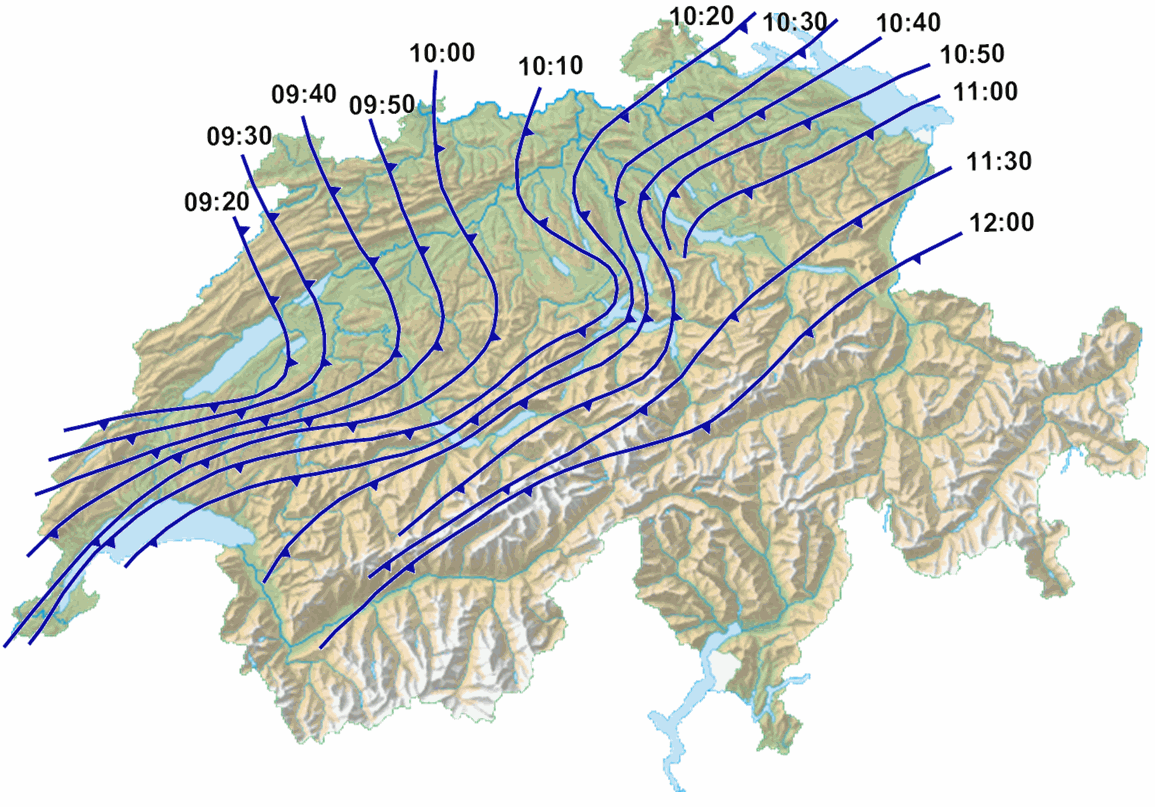
Avancée rapide sur le Plateau
Après avoir franchi le Jura, le front froid s'est déplacé à une vitesse impressionnante vers l'ouest du Plateau, prenant toujours une forme arquée en direction de la Suisse centrale. La pointe de l’arc s'est manifestement déplacée par moments à une vitesse de 150 km/h environ. En effet, entre 10h00 et 10h10 UTC, à peine 20 minutes après la traversée du Jura, la partie orientale du front froid atteignait déjà la Suisse centrale. Au même moment, la partie sud du front froid laissait Berne derrière elle et commençait à pénétrer dans les Alpes un peu plus tard.
Un foehn violent souffle simultanément sur les Alpes
Peu après 10.00 UTC, l'avancée du front froid s'est ralentie en progressant vers l’est. En Suisse centrale, Lothar s'est heurté au foehn. Le centre de basse pression passant au nord de la Suisse, un important gradient de pression sud-nord s'est établi au-dessus de l'espace alpin. Cela a déclenché temporairement un violent courant de foehn à l'approche du front.
Alors que le front froid ralentissait en Suisse centrale, les masses d'air se déplaçaient avec force le long des lacs de Thoune et de Brienz vers l'Oberland bernois. À Brienz, la pointe du vent a atteint la valeur exceptionnellement élevée de 181 km/h. Vers 10h30 UTC, un large front froid a finalement pu se former le long de l'ouest du versant nord des Alpes et sur le centre du Plateau (image 7).
L'Oberland bernois a été la seule région où le front froid a réussi à s'enfoncer un peu plus profondément dans les Alpes. Le passage du front froid ne peut toutefois être reconstitué que de manière lacunaire dans cette région, car on ne dispose que des stations de mesure de Boltigen (Simmental) et d'Adelboden. Boltigen a été atteint par le front froid avec des pointes de vent de plus de 150 km/h vers 10h30 UTC. À Adelboden, en revanche, les rafales maximales de 120 km/h se sont produites avant 10h00 UTC, et celà avec une direction du sud-sud-ouest. Il semble ainsi que dans certaines vallées de l'Oberland bernois, ce ne soit pas le front froid qui a causé les rafales les plus élevées, mais le foehn déclenché au passage de la dépression.
Évacuation rapide du front sur l'est de la Suisse
En raison du déplacement rapide du centre dépressionnaire au-dessus de l'Allemagne en direction de l’est, le front froid a pris une orientation est-ouest. Alors qu'il ne se déplaçait que lentement vers l'est en Suisse centrale, il a progressé en moins d'une heure entre le Rhin et le versant nord des Alpes. En raison de ce mouvement vers le sud du front froid, l'est de la Suisse a été rapidement touché par la tempête, et la masse d'air froid a pénétré à grande vitesse dans les vallées de la Reuss et du Rhin à partir de 12h00 UTC environ, suite à l'augmentation de la pression sur le Plateau.
Des analyses statistiques sur la fréquence des vitesses de vent élevées en Suisse sont disponibles sur la base d'un grand nombre de séries de mesures pour la période de mesure de 1981 à 2022.
Il ressort de ces analyses qu'une tempête de la force de Lothar est attendue en moyenne tous les 30 à 100 ans environ en plaine au nord des Alpes. Sur plusieurs sites de mesure, il s'agit d'un événement d'une période de retour de 50 à 100 ans, alors que pour certains, on obtient des périodes de retour de plus de 100 ans.
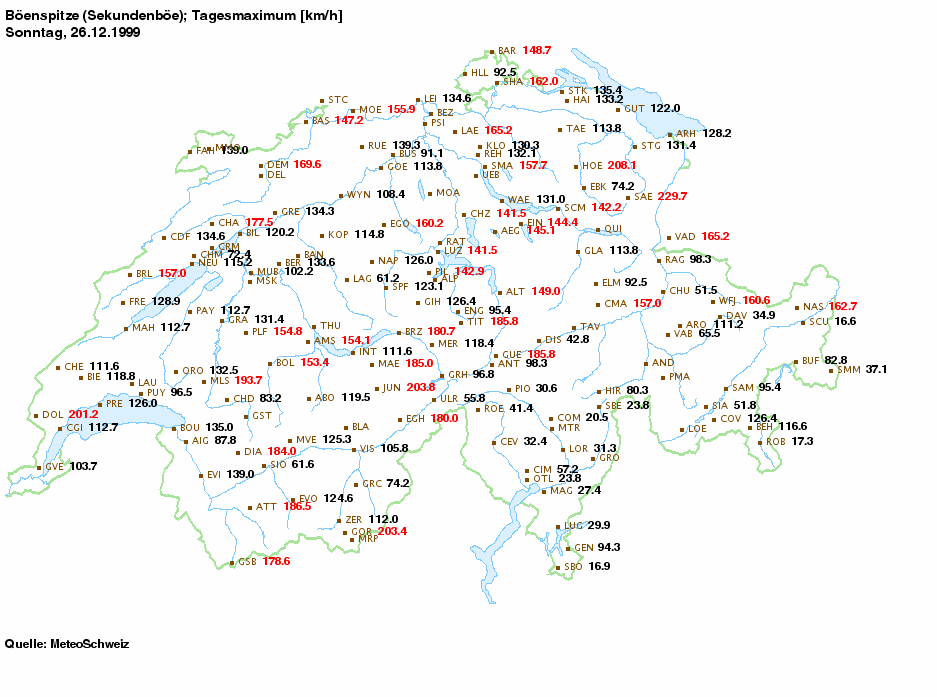
La mise en place de la procédure actuelle des alertes d'intempéries
Interview de Saskia Willemse , cheffe d'équipe Systèmes d'alerte

Saskia, tu travaillais comme météorologue à l'ISM au Zurichberg pendant l'ouragan Lothar. Une rafale de 158 km/h a été mesurée sur le toit. Comment as-tu vécu cette tempête extrême ?
Ce jour-là, j'étais de service du soir. Lorsque les plus fortes rafales ont balayé Zurich, j'étais encore chez moi et j'ai sous-estimé l'ampleur des dégâts, car j'habitais dans un endroit protégé du vent. Ce n'est qu'en me rendant au centre météorologique, alors que de nombreuses rues étaient bloquées par des arbres tombés, que j'ai réalisé la gravité de la situation.
Au centre, j'ai vu sur les modèles de prévision une zone de basse pression qui ressemblait à une cible - je n'avais jamais vu une dépression aussi creusée. Les modèles étaient alors moins fiables, et l'ampleur totale de l'ouragan n'est devenue claire que lorsque les premières mesures sont arrivées de France.
Même avec de meilleures prévisions, il aurait été difficile d'alerter la population : il n'y avait pas de niveaux d'alerte standardisés ou de régions d'alerte définies. Les informations étaient presque exclusivement diffusées par le biais d'interviews radiophoniques. Seuls des lacs et les aéroports disposaient de canaux d'alerte institutionnalisés.
La série d'intempéries de 1999 a déclenché le développement des systèmes d'alerte en Suisse. Au lieu de n'avertir que les lacs et les aérodromes, il existe aujourd'hui un système à plusieurs niveaux pour 159 régions. Mais sommes-nous vraiment bien préparés aux intempéries ?
Beaucoup de choses ont changé au cours des 25 dernières années : la prévision des événements extrêmes, la diffusion des alertes et la coordination des processus d'alerte ont été considérablement améliorées. Peu après 2000, un premier système d'alerte national a été mis en service, couvrant 14 régions.
Les intempéries d'août 2005 ont conduit à la prochaine étape de développement : le Comité de pilotage Intervention dangers naturels (LAINAT) a été créé pour mieux coordonner les alertes et les communiquer de manière centralisée. Parallèlement, le Conseil fédéral a approuvé le premier train de mesures OWARNA, qui a permis de renouveler le réseau de radars et de mesures au sol et d'augmenter le nombre de régions d'alerte de 14 à 159.
Avec OWARNA 2 (depuis 2018/19), le système d'alerte continue d'évoluer : Nouveau logiciel, automatisation des étapes de travail, amélioration des contenus et optimisation des échanges avec les autorités cantonales sont des mesures essentielles.
En 1999, il n'existait pratiquement pas de systèmes d'alerte destinés à la population. Aujourd'hui, le public a de nombreuses possibilités d'être alerté. Que penses-tu de cette évolution ?
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de lancer des alertes de manière nettement plus efficace qu'en 1999, ce qui constitue un grand progrès. Mais la multiplication des canaux et des fourmisseurs fait que la population est littéralement submergée d'alertes. MétéoSuisse a pour mission légale d'avertir en cas d'intempéries, mais d'autres institutions et des particuliers émettent également des alertes. Celles-ci se propagent via des applications, des sites web, des médias sociaux et des médias en ligne. Trop d'alertes réduit l'impact de celles-ci et leur faire perdre leur caractère de « réveil »
Trop d'alertes peuvent donc rendre le public confus et l'empêcher de réagir en cas d'urgence. Mais MétéoSuisse avertit également les autorités cantonales. Comment fonctionne cette chaîne d'alerte ?
Les autorités cantonales reçoivent les mêmes alertes que la population à partir du troisième niveau de danger (orange), mais elles bénéficient de services supplémentaires. Le « briefing à distance pour les autorités » a été introduit il y a environ deux ans. Lors de cette vidéoconférence, des prévisionnistes expliquent la situation et les incertitudes en cas d'alerte. Les responsables des dangers naturels qui y participent peuvent poser des questions sur la situation et échanger directement leurs points de vue. Ce service de MétéoSuisse a reçu de nombreuses réactions positives.
Le système fédéral permet aux cantons de publier des alertes locales avec des informations sur les conséquences et des recommandations de comportement. Pour ce faire, l'Office fédéral de la protection de la population utilise la plateforme AlertSwiss. Comme les alertes de la Confédération n'y sont pas publiées directement, mais que la plateforme est tout de même reconnaissable en tant que plateforme fédérale, il n'est souvent pas clair d'où proviennent les alertes.
Le système fédéral prévoit en outre que les cantons informent les communes des dangers naturels, mais cela varie d'un canton à l'autre. Les communes sont souvent les premières à devoir prendre en charge la gestion en cas d'intempéries. Dans certains cantons, elles ne reçoivent toutefois pas les alertes de MétéoSuisse par le biais des autorités cantonales, mais doivent s'informer par des canaux publics.
Les alertes aux intempéries ne sont-elles efficaces que si les canaux de diffusion, les autorités et les forces d'intervention impliquées sont bien coordonnés ?
Oui, l'exemple tragique de Valence (Espagne) fin octobre 2024 montre ce qui peut arriver si la chaîne d'alerte ne fonctionne pas sans faille. Une alerte aux intempéries ne suffit pas à elle seule - elle doit atteindre les bons destinataires, être compréhensible et permettre aux personnes concernées de réagir de manière appropriée.
Le service météorologique avertit des dangers et donne des recommandations de comportement. Les autorités doivent évaluer la situation au niveau local et prendre des mesures de protection. Pour ce faire, elles doivent exercer leur organisation de crise en « période calme » et s'assurer qu'elles peuvent communiquer efficacement avec la population en cas d'urgence.
Le Valais et le Sud des Alpes, en particulier le Val Maggia et la Mesolcina, ont été frappés à plusieurs reprises cet été par de graves intempéries qui ont causé d'importants dégâts et malheureusement fait des victimes. La chaîne d'alerte a-t-elle fonctionné lors de ces événements ?
Cette question fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie, à laquelle participent aussi bien des institutions fédérales que des représentants des cantons concernés, raison pour laquelle je ne veux pas encore anticiper sur les détails.
Ce que je peux dire, en revanche, c'est que la collaboration entre le centre de prévision de MétéoSuisse à Locarno Monti et les autorités cantonales fonctionne généralement bien. Ils communiquent directement et ont des procédures bien rodées, ce qui est facilité par le partenariat exclusif avec le canton du Tessin et les vallées du sud des Grisons. En Suisse alémanique et en Suisse romande, c'est plus difficile. Le centre de prévisions de Zurich-Kloten, par exemple, dessert 19 cantons et demi-cantons, qui travaillent chacun différemment.
Les alertes d'intempéries resteront un thème pertinent dans les années à venir. Ainsi, le mot « Murgang » (lave torrentielle) a atteint la troisième place du classement ZHAW (Zurich University of Applied Sciences) des mots de l'année 2024 en Suissse alémanique, et « allerta meteo » a occupé la deuxième place en Suisse italophone. Comment le système d'alerte de MétéoSuisse va-t-il évoluer ?
Les destinataires des alertes météorologiques veulent avant tout connaître les conséquences du temps qu'il fera, plutôt que la forme qu'il prendra. À l'avenir, outre l'amélioration de la détection des phénomènes météorologiques extrêmes, l'accent sera davantage mis sur la prévision des conséquences possibles. Cela concerne aussi bien les dommages directs, comme les routes ou les bâtiments détruits, qu'indirects, comme les perturbations du trafic. De telles prévisions ne peuvent pas être faites de manière globale, mais seulement de manière ciblée pour certains scénarios et sur la base de probabilités. La forme et le contenu de ces informations sur les conséquences doivent donc être développés en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux, en l'occurrence les autorités cantonales.
Les avertissements ne seront donc pas exacts à l'avenir non plus ?
Malgré toutes les améliorations apportées à nos systèmes d'alerte, une marge d'incertitude subsiste. Cela vaut non seulement pour la météorologie, mais aussi pour d'autres prévisions telles que les prévisions économiques. Les prévisions météorologiques et les alertes aux intempéries ne sont pas parfaitement exactes, comme un horaire de train par exemple. Même dans le cas d'un horaire, des événements météorologiques extrêmes, comme les fortes chutes de neige de fin novembre 2024, peuvent provoquer des irrégularités. Malgré les progrès réalisés, nous devrons continuer à vivre à l'avenir avec cette incertitude.
(Interview et rédaction Andreas Hostettler)
Liens vers la tempête Lothar
25 ans après Lothar : comment la tempête a transformé la forêt
Blog de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)
TJ midi - 26 décembre 1999 - Archives RTS
Après Lothar (17 février 2000) - Temps Présent, archives RTS
La Tempête du Siècle - Lothar & Martin Décembre 1999
(document de 1h30 sur Lothar avec un focus sur la France et les prévisions de Météo France
PRODUCTEUR : Gedeon Programmes / France 3, France 5, CFI, TV5 DATE : 2004
Vagues sur le lac et inondations des quais de Vevey (vidéo YouTube)